 Droit d’auteur sur le logiciel ou droit d’hauteur ?… Voilà donc une bien curieuse orthographe glissée dans cet inséparable couple que constituent le logiciel et le droit d’auteur… Mais que vient donc faire ce « H » vilainement appuyé sur l’auteur forçant notre œil à cligner en dérangeant ainsi notre lecture ? Ce « H » interpelle !! Ne serait-ce pas là, un bogue ?… Ou une anomalie, glissée dans ce couple si logiquement formé entre le droit d’auteur et le logiciel ?… Sinon, quel pourrait donc bien être ce mot valise que masquerait un « H » immiscé de la sorte ? Voilà donc une expression qui pourrait tout droit s’échapper d’une foliation du Parti pris des choses (Francis Ponge, Le Parti pris des choses, Gallimard, 1996) ? Ce Parti pris dans lequel Francis Ponge n’a pourtant pas, à bien lire, souhaité laisser de place au logiciel… Car même si le « H » avait pu donner quelque hauteur à l’auteur, le logiciel ne serait jamais pour autant devenu chose…Pas plus en poésie qu’en droit…N’en déplaise aussi à l’autre poète, celui de l’Inventaire (Jacques Prévert, Paroles, Folio Gallimard, 1976) et aux éditeurs de logiciel qui en évoquent et revendiquent le droit ! S’il y a « plusieurs ratons laveurs » dans cet Inventaire c’est que plusieurs logiciels devraient s’y trouver aussi non, non ?… « Vérifiez bien, car attention !!… Droit d’auteur ou pas droit d’hauteur, rien, non rien, n’autorise ce « H », tranchant sans manche, à venir impunément couper l’auteur de son droit ! » Et pourtant, dans la licence de logiciel, existe aussi un parti pris… : le Parti pris des clauses dont le code de lecture appartient à l’éditeur qui en maîtrise les arcanes et jongle avec les métriques, comme Francis Ponge le faisait avec son cageot et son cachot.
Droit d’auteur sur le logiciel ou droit d’hauteur ?… Voilà donc une bien curieuse orthographe glissée dans cet inséparable couple que constituent le logiciel et le droit d’auteur… Mais que vient donc faire ce « H » vilainement appuyé sur l’auteur forçant notre œil à cligner en dérangeant ainsi notre lecture ? Ce « H » interpelle !! Ne serait-ce pas là, un bogue ?… Ou une anomalie, glissée dans ce couple si logiquement formé entre le droit d’auteur et le logiciel ?… Sinon, quel pourrait donc bien être ce mot valise que masquerait un « H » immiscé de la sorte ? Voilà donc une expression qui pourrait tout droit s’échapper d’une foliation du Parti pris des choses (Francis Ponge, Le Parti pris des choses, Gallimard, 1996) ? Ce Parti pris dans lequel Francis Ponge n’a pourtant pas, à bien lire, souhaité laisser de place au logiciel… Car même si le « H » avait pu donner quelque hauteur à l’auteur, le logiciel ne serait jamais pour autant devenu chose…Pas plus en poésie qu’en droit…N’en déplaise aussi à l’autre poète, celui de l’Inventaire (Jacques Prévert, Paroles, Folio Gallimard, 1976) et aux éditeurs de logiciel qui en évoquent et revendiquent le droit ! S’il y a « plusieurs ratons laveurs » dans cet Inventaire c’est que plusieurs logiciels devraient s’y trouver aussi non, non ?… « Vérifiez bien, car attention !!… Droit d’auteur ou pas droit d’hauteur, rien, non rien, n’autorise ce « H », tranchant sans manche, à venir impunément couper l’auteur de son droit ! » Et pourtant, dans la licence de logiciel, existe aussi un parti pris… : le Parti pris des clauses dont le code de lecture appartient à l’éditeur qui en maîtrise les arcanes et jongle avec les métriques, comme Francis Ponge le faisait avec son cageot et son cachot.
Le droit d’hauteur avec son « H » de circonstances, ressemblant au premier barreau d’une « très Pongienne » échelle, est donc une invitation à prendre de la hauteur. Hauteur sur la rédaction de la licence logicielle ; hauteur sur la rédaction de ses clauses, mais aussi hauteur sur ce droit tout puissant, quasi régalien de l’auteur… Une hauteur de vue aujourd’hui cruciale tant la rédaction de la licence et sa relation intriquée avec le droit d’auteur, peuvent être en faux semblants pour un utilisateur. Ce dernier, perdu dans les arcanes d’un labyrinthe contractuel sans fil d’Ariane ni réelle sortie, est conduit à des engagements pas toujours maîtrisés, qui peuvent être dangereux pour la pérennité de son activité. Ils sont d’autant plus dangereux que les logiciels affectent toutes les fonctions des organisations, toutes les directions de l’entreprise et que le régime de protection de l’auteur, associé à la double vocation intégrative et évolutive du logiciel, crée à l’épreuve du temps et au-delà de tout contrat, une situation de fragilité et de déséquilibre au détriment de l’utilisateur. Dès lors, se pose la question de savoir si la situation de dépendance dans laquelle une organisation peut se trouver, vis-à-vis de ses logiciels, ne confine pas à une situation de vulnérabilité ou de faiblesse qui nécessiterait une protection particulière, en balance d’un droit d’auteur trop puissamment consacré qui avec le temps, dénature l’équilibre contractuel en transformant le rapport de droit en un rapport de force précarisant l’utilisateur.
Droit d’auteur sur le logiciel : une protection à effets monopolistiques
La puissance de protection de l’auteur par le droit tient à la qualité d’œuvre de l’esprit reconnue au logiciel, depuis la loi du 3 juillet 1985 (art. L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle). Elle donne à l’auteur un pouvoir exclusif de déterminer ses conditions d’exploitation en fixant les règles d’utilisation par le contrat de licence. Selon la loi, le droit d’exploitation s’entend largement : il comprend la mise sur le marché, la reproduction, la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification du logiciel. L’auteur est libre d’exercer lui-même ses prérogatives ou d’en autoriser l’exercice par des tiers (art. L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle). Mais, cette dernière hypothèse n’est techniquement opérante qu’avec un accès accordé aux codes sources du logiciel. Or compte tenu des investissements en matière de recherche et de développement pour produire un logiciel, l’auteur en pratique, concède très rarement, sauf à y être contraint ces prérogatives. Il les conserve et les exerce de manière exclusive en limitant les droits sur son logiciel, et de ce fait aussi, les conditions de son utilisation au point de constituer un effet de monopole sur cette dernière. Ainsi, l’auteur circonscrit-il classiquement les droits de licence, sur un territoire donné, aux droits :
– d’installer la solution, avec des limites posées en fonction des types ou des modèles de serveurs (métrique) des géographiques où ils se trouvent ;
– d’utiliser la solution dans un ou plusieurs environnements (production, machine, SaaS, cloud computing) avec un accès géographique limité et sur un périmètre d’utilisateur identifiés limités par exemple aux employés d’une même entité juridique, à l’exclusion des autres préposés (consultants, infogérants etc..) ou filiales ;
– de sous-licencier à des entités d’un même groupe de sociétés, des tiers ou bien à des clients finaux, selon certaines prescriptions particulières.
Cette liste donnée à titre d’exemple n’est pas exhaustive. Mais, insérée dans un contrat de licence, elle devra durant son exécution être d’interprétation stricte. Une utilisation en dehors des règles posées par la licence conduit à une faute susceptible de condamnation par les tribunaux, dès lors que la licence « a un périmètre d’utilisation précis et exempt de toute ambiguïté » (Cour d’Appel de Paris, 4e ch., 23 mai 2007, RLDI 2007/28, n° 914). Or l’arsenal des sanctions est quelque peu dissuasif. Qu’il soit intentionnel ou non, le fait, pour un utilisateur, d’outrepasser les droits de licence qui lui ont été concédés, répond donc à une situation d’utilisation contrefaisante. Cette situation qualifie un délit de contrefaçon puisque, constitue un « délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 » (art. L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle). C’est le cas lorsque :
- un logiciel est utilisé sur un nombre de postes excédant celui prévu au contrat (Cour d’Appel de Paris, 27 mars 1998, Gaz. Pal. 1999. 2, somm p. 603) ;
- un logiciel est installé sans autorisation de son auteur (Cour d’Appel de Nancy, 12 sept. 2002, Expertises 2003, p.71).
Outre le risque de saisie qui empêche l’utilisation du logiciel, l’utilisateur peut être condamné à verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’auteur du fait de son manque à gagner ; il peut aussi tomber sous le coup d’une possible condamnation pénale à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (art. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle). Cette sanction peut être portée à son quintuple, si le délit est commis par une personne morale (société, association).
Ce régime très protecteur au travers du monopole accordé à l’auteur ainsi que les sanctions sévères qui sont attachées à la contravention de ses droits ne laisse que très peu de marge de manœuvre à l’utilisateur. Qui n’a pas lu son contrat ne licence ne sait pas quelle utilisation il peut faire de son logiciel ! Qui a, de manière compulsive, téléchargé son appli en cliquant « ok » sans lire les (longues) conditions de licence, ne connaît pas son appli, ni ne sait vraiment ce qu’il peut en faire !… Il y a auteur et hauteur, il y a hauteur et recul, recul et dilettantisme…
Droit d’auteur et logiciel : une situation d’équivoques ?
« Et bien ! », se dit le lecteur averti de La Loi des Parties, « il en va finalement de l’œuvre logicielle et de son droit d’auteur comme de certains autres droits.. ». Oui, certes, sauf que… Sauf qu’il persiste en matière de logiciel une sorte d’équivoque… une équivoque qui sans confiner pleinement à une situation d’erreur, place pourtant d’emblée l’utilisateur, en rapport du droit d’auteur, dans une position amoindrie. Cette position amoindrie de l’utilisateur de logiciel subsiste dans notre droit des contrats, malgré une jurisprudence toujours plus soucieuse d’équilibre mais qui bogue sur le droit d’auteur, faute de saisir l’équivoque sur laquelle peut reposer la conclusion de la licence logicielle. Exerçons ensemble notre droit d’hauteur…
La situation d’équivoque se situe dans les motivations profondes qui conduisent à la conclusion d’une licence d’utilisation du logiciel. Il paraît persister, dans la rencontre des consentements une ambiguïté à propos de la licence de logiciel. En effet, pour l’utilisateur, sa motivation à souscrire à la licence réside, au-delà de l’usage auquel il destine le logiciel, dans sa finalité ultime : c’est-à-dire le résultat fiable que l’utilisateur est censé obtenir par le jeu des fonctionnalités. En un mot, ce qui motive l’utilisateur, ce qui le conduit à consentir à la licence ce sont les fonctionnalités du logiciel, ou pour être plus exact le bénéfice qu’il pourra tirer de son utilisation : les résultats qu’il va tirer du jeu du logiciel. L’approche de l’éditeur de logiciel est différente en ce qu’il consent de son côté, une somme de droits sur son produit logiciel, dont le contenu fonctionnel, peut varier dans le temps, en fonction des aléas techniques et des évolutions technologiques. Mais là resurgit le parti pris des clauses de l’éditeur…. Ainsi, à la différence des autres œuvres de l’esprit, qui en quelque sorte se détachent des droits qui en protègent l’auteur, les règles, établies par l’auteur en matière logicielle, font pour ainsi dire, corps avec la solution logicielle elle-même. Ces règles lui sont, d’une certaine manière, indivisibles, confondues avec le logiciel qui ne peut donc être appréhendé autrement que par son droit d’usage tel que posé par la licence, avec lequel il se fond, tandis que dans l’esprit de l’utilisateur, c’est un droit aux résultats auquel il souscrit. Ce « frottement » des consentements dans la contractualisation, à défaut de rencontre, semble aussi se retrouver dans les incertitudes doctrinales et jurisprudentielles qui ont dominé les débats juridiques relatifs à la qualification du contrat de licence de logiciel : s’agit-il d’un contrat de location, d’un contrat de vente, ou bien encore d’un contrat innommé au régime hybride empruntant tant à la location qu’à la vente ?
La situation d’équivoque peut aussi naître de l’absence de finitude de l’œuvre logicielle. En effet, bien qu’élevé rang d’œuvre par le Code de la propriété intellectuelle, le logiciel n’est pas une œuvre « figée ». Il s’agit d’une œuvre quasi-vivante en ce qu’elle est animée par un besoin permanent de corrections. Elle se trouve aussi en perpétuelle évolution par l’adjonction d’améliorations, de fonctionnalités nouvelles ou de besoins particuliers de performance. En un mot, tout se passe comme s’il s’agissait d’une œuvre jamais achevée, toujours à parfaire. Cette situation constitue en réalité un état de fait qui s’impose à cette « industrie » et qui semble entacher le droit consenti à l’utilisateur d’une certaine fragilité, d’une imprévisibilité par rapport au résultat attendu qui a motivé la souscription de la licence du logiciel par l’utilisateur. L’utilisateur n’a pas d’autre choix que d’accepter, lorsque il contracte, les anomalies inhérentes à venir liées au caractère non figé et imparfait du logiciel. Il va devoir « faire avec » cette réalité tout au long de l’exécution du contrat et en assumer les conséquences sur son activité.
Concrètement, cela implique, pour l’utilisateur, une acceptation implicite de la possible apparition de bogues ou d’anomalies dont la gravité peut à tout moment empêcher le bon fonctionnement du logiciel ou l’atteinte des résultats attendus dans lesquels réside, paradoxalement, les motivations de son consentement à la licence. Cela signifie aussi de devoir consentir à une instabilité de la solution, par le jeu des corrections, des évolutions et des nouvelles versions, rendues au fil du temps nécessaires pour parfaire le logiciel. Enfin, cela suppose aussi pour l’utilisateur, l’acceptation contrainte de la survenance d’une obsolescence plus ou moins prévisible de la version logicielle qu’il utilise en production. Elle correspond à la situation de péremption dans laquelle se trouve une version du logiciel en production qui, du point de vue de l’éditeur, n’est techniquement plus maintenable (sans qu’il soit pourtant généralement avancé de preuve de cet état de fait technique). Née par l’effet combiné de l’évolution technique et du fait qu’il est, pour un éditeur, économiquement et techniquement difficile de maintenir un nombre important de versions en cours, l’obsolescence d’une version met l’utilisateur face à une cornélienne alternative.
- Soit l’utilisateur conserve en production une solution obsolète. Il court alors le risque que cette version génère des bugs qui ne seront pas corrigés. Ils seront d’autant plus pénalisants que le service de correction ou de maintenance ne sera plus assuré, sauf selon un bon vouloir de l’éditeur. On comprend alors que, sauf à réaliser lui-même la maintenance, le licencié puisse se trouver dans une situation ne lui permettant plus d’utiliser le logiciel de manière pérenne dans la durée, conformément à l’usage auquel il le destinait. L’utilisateur peut être autorisé, par stipulation expresse de la licence à lui-même à continuer la maintenance du logiciel ou recourir au service d’un tiers pour ce faire. Cependant ceci nécessite d’avoir négocié au préalable un accès aux codes sources du logiciel. A défaut l’utilisateur n’a pas d’autre choix que de souscrire une « montée de version » ou de se tourner vers le choix d’un autre logiciel.
- Soit l’utilisateur « décide » d’opérer directement une montée de version du logiciel pour en pérenniser (ou plutôt prolonger !) l’utilisation et en préserver la destination initiale. Elle implique la souscription de nouveaux droits, de nouvelles règles d’utilisation et de maintenance, l’imbrication de nouveaux prix et de nouvelles métriques, dans des conditions de négociation qui peuvent apparaître très théoriques du point de vue de l’utilisateur et qui pourraient confiner à une situation d’adhésion forcée.
Logiciel : situation d’équivoques et dépendance… vers une précarité technologique contractuelle
Quel que soit le cas retenu, on perçoit que le jeu nécessaire de la maintenance corrective et évolutive institue une véritable fragilité des droits de l’utilisateur. Derrière le droit de l’auteur et le contrat de licence se cachent en réalité d’autres contrats dont le caractère prévisible est à la seule maîtrise de l’auteur qui en décide du rythme et des conditions, en fonction de ses évolutions techniques. Il sera objecté à ce stade que les règles du jeu liées à cette industrie acceptées de fait comme un quasi-usage, sont au départ connues de l’utilisateur. Professionnel ou non, il aurait par ailleurs toujours la faculté de se départir du logiciel en en cessant l’utilisation ou en résiliant la licence pour reprendre sa liberté contractuelle et souscrire à une autre solution.
Toutefois, on ne saurait se satisfaire de cette approche si on considère, dans le temps, le caractère éminemment intégratif du logiciel, pourtant partiellement reconnu par le Code de la propriété intellectuelle (art. L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle). En effet, la vocation intégrative inhérente au logiciel à fonctionner et à interagir avec d’autres environnements, systèmes et solutions rend les facultés d’en cesser l’utilisation ou de s’en départir, difficiles à mettre en œuvre : plus la solution est interconnectée, plus cette approche peut être rendue délicate dans les effets de bord qu’elle peut susciter : nouveaux bogues, anomalies, interruptions de service etc. Or, le phénomène intégratif s’accroît, avec le temps augmentant aussi la dépendance de l’entreprise à la technologie logicielle souscrite. Aussi, plus les fonctionnalités du logiciel s’inscriront intimement dans l’exploitation d’une entreprise, plus les effets liés à la réalité de son imperfection s’imposeront à l’utilisateur et moins ce dernier sera en position de discuter des modifications, des conditions de maintenance, d’évolution du logiciel ou de son obsolescence. Sauf à risquer de se plonger plus encore dans la difficulté, les droits à négociation ou à résiliation de l’utilisateur seront fragilisés.
Cette situation créée avec le temps, se rapproche quasi indubitablement d’une situation de faiblesse en ce que l’une des parties au contrat de licence logiciel, en l’occurrence l’utilisateur, ne peut au moment de sa conclusion préjuger de ce que deviendra le logiciel dans ces propres systèmes d’information ni des futures règles de sa jouissance paisible permettant de pérenniser son utilisation. De l’autre côté, l’auteur est dans une situation de maîtrise des cycles de vie de ses logiciels (évolutions, versions, obsolescence) et surtout des conditions de maintenabilité et de maintenance des versions en cours d’utilisation par les utilisateurs. La maîtrise de ces éléments met une partie à la merci de l’autre en offrant la possibilité à cette dernière de forcer le contrat au détriment de l’autre.
Et le droit alors ??
Les mesures correctives par le droit des effets négatifs du temps sur les conditions contractuelles que les juges, puis le législateur ont déjà pu apporter (en considérant par exemple au-delà du contrat, l’ancienneté de la relation) ne sont pas satisfaisantes. Elles semblent en effet méconnaître la « dépendance technologique » dont le jeu bouleverse tant l’économie initiale que l’équilibre du contrat. Le droit n’offre à ce jour qu’une protection inadéquate en pareilles circonstances. S’il reconnaît que peuvent exister des situations d’exploitation abusive des situations de dépendance économique, ces dernières ne peuvent être invoquées que lors de la formation du contrat pour une demande de nullité. En effet, le Code civil dispose qu’ »il n’y a point de consentement valable si le consentement (…) a été extorqué par violence » (Code civil, article 1109). Il précise qu’ »il y a violence lorsque elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent »(Code civil, article 1112 ).
Ces dispositions prévues en cas de violence physique, ont été étendues par les juges. La jurisprudence a admis qu’une partie pouvait être contrainte de conclure un contrat sous une violence économique en assortissant cette situation de certains critères de qualification. Afin que la situation de dépendance puisse être reconnue, il faut que l’utilisateur soit en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’une situation de dépendance économique et de son exploitation abusive.
La qualification d’une situation de dépendance économique de l’utilisateur vis-à-vis de l’éditeur ne peut être établie que si l’utilisateur n’avait pas d’autre solution, ni alternative raisonnable. L’existence d’une alternative exclut toute qualification possible de dépendance et donc de contrainte. Ainsi, la jurisprudence refuse d’admettre qu’un cocontractant est dans une situation de dépendance économique s’il peut, avant de conclure le contrat litigieux, recourir à un autre partenaire avec une solution équivalente, tant sur le plan technique que sur le plan économique, et notamment si elle est accessible en temps utile (Y.-M. Laithier, « Remarques sur les conditions de la violence économique », LPA, 22 novembre 2004, n° 233, p. 6). On pourrait donc conclure que s’il n’existe aucun obstacle juridique ou factuel à la possibilité d’obtenir un produit logiciel auprès d’un tiers, l’utilisateur ne saurait se trouver dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l’éditeur. Ces critères ne sont pas satisfaisants en matière de logiciel, puisque le fait de trouver ou non une autre solution logicielle ne suffit pas à déterminer une situation de dépendance. Ce qui qualifie la dépendance en matière de logiciel est à chercher dans la combinaison du besoin inhérent de correction optimisée des anomalies ou de maintenance et l’exclusivité de cette activité que se réserve l’auteur !!
En outre, le fait que l’utilisateur de logiciel soit placé, au moment de la conclusion du contrat de licence de logiciel, dans une situation de dépendance économique ne suffit pas à justifier l’annulation du contrat ; il faut démontrer que l’éditeur ou l’auteur a exploité ou a abusé de cette dépendance pour imposer des conditions anormales. Autrement dit, l’éditeur doit avoir obtenu de l’utilisateur des conditions contractuelles qu’il n’aurait pas obtenues en l’absence de situation de dépendance économique. Ainsi la jurisprudence a-t-elle pu décider que « le simple constat d’une situation de dépendance économique ne suffit pas à légitimer une sanction sur le fondement de la violence, et qu’il convient de prouver que la partie forte au contrat a abusé de sa position dominante, l’abus s’appréciant au regard de l’équilibre du contrat et de l’avantage excessif octroyé au détriment de la partie faible » (Cour d’Appel de Paris, 23 mai 2012, RG n° 09/22953). Dès lors, il revient à l’utilisateur demandant la nullité de la licence de démontrer que, en raison de l’exploitation abusive de sa situation de dépendance économique par l’éditeur, il a conclu un contrat de licence de logiciel qui n’est pas conforme à ses intérêts et que, sans l’abus de l’éditeur, il n’aurait pas conclu la licence ou, à tout le moins, à des conditions différentes.
A la lecture de cet exposé très juridique, on perçoit qu’il sera, en l’état du droit, compliqué pour l’utilisateur d’invoquer la violence ou l’abus de dépendance pour tenter de rééquilibrer sa situation logicielle. En effet, ce n’est pas lors de la formation de la licence que semble se dessiner la situation de dépendance susceptible d’abus. C’est à l’épreuve du temps qu’elle s’instaure à rebours du jugement d’appréciation de l’utilisateur. Ce dernier contribue en quelque sorte à la réalisation de sa précarité contractuelle. En sus, la sanction de nullité du contrat et les conséquences auxquelles elle aboutit (changement de logiciel) ne sont-elles pas un pire remède que la situation qu’elles doivent corriger ?
Enfin, en exigeant la souscription d’un contrat de maintenance ou un changement de version à ses conditions, l’éditeur est bien caché dans l’exercice de ses prérogatives d’auteur, protégé par son droit de modification et de correction de son œuvre inachevée. Au bout du compte ce qu’il offre, par le double jeu des contrats de licence et de maintenance qui se causent l’un l’autre et verrouillent l’utilisateur dans un droit berçant de jouissance paisible, n’est ni plus ni moins qu’une promesse de perfection du logiciel et des droits de l’auteur, « le Parti pris des clauses », disent certains, « en attendant Godot » (Samuel Beckett, En attendant Godot, Editions de Minuit, 1948) répondent d’autres…
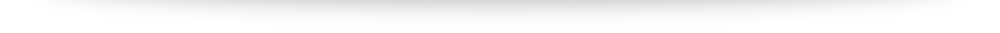
No Comments